J’ai longtemps cru qu’un bon dashboard parlait de lui-même.
Qu’avec des chiffres clairs, des courbes lisibles et un peu de storytelling, la prise de décision suivrait naturellement.
Erreur de jeunesse.
La vérité, c’est que mes dashboards étaient souvent applaudis… puis oubliés.
Ils terminaient leur vie dans un dossier partagé, version 3.6, entre un brief de campagne et un plan média.
Le problème n’était pas mes analyses. C’était la maturité analytics autour de moi.
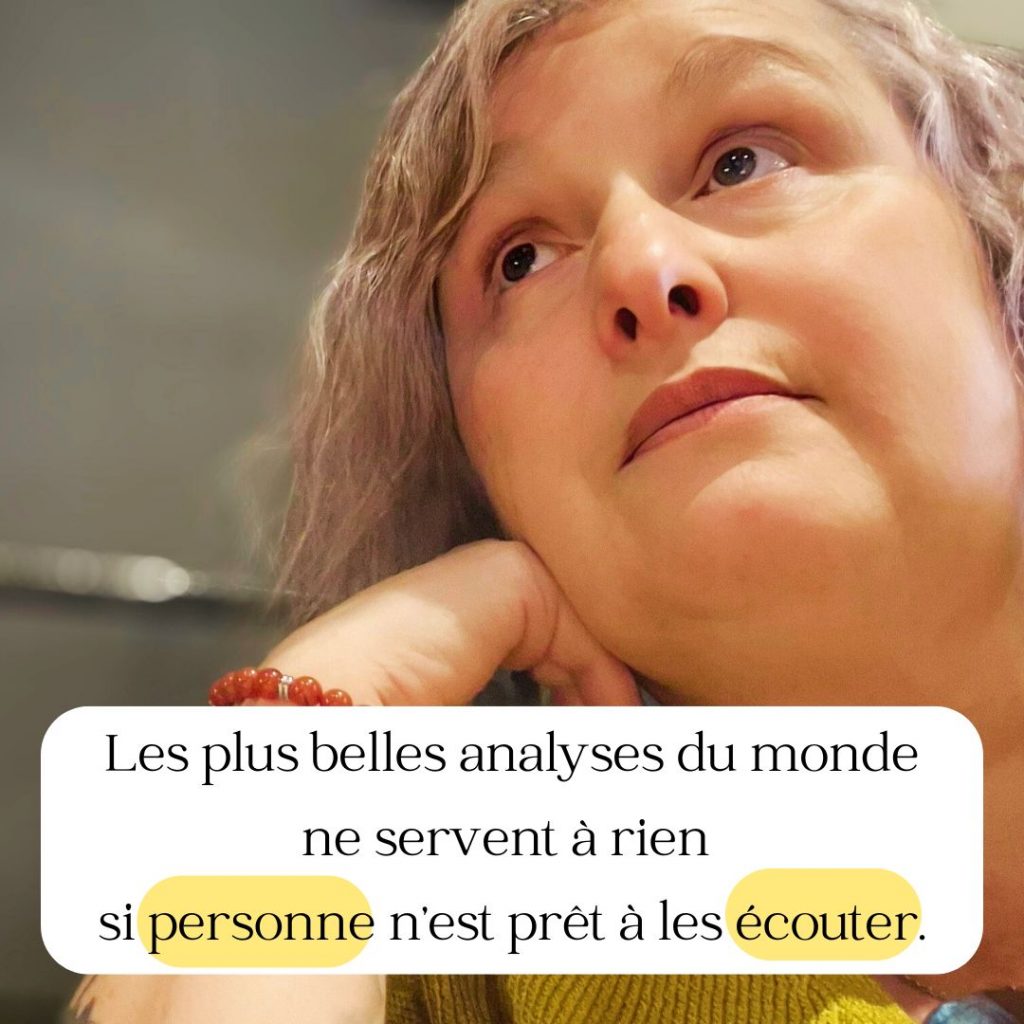
Entre la donnée et la décision, il y a… la culture
On parle beaucoup de data-driven, moins de data-compréhension.
Or, la maturité analytics, ce n’est pas une question d’outils ni de volume de données. C’est une posture collective : savoir écouter, traduire et oser questionner ce que les chiffres révèlent.
Sans cette culture-là, on peut bien avoir GA4, Looker Studio, BigQuery et un Data Scientist par étage… les décisions continueront à se prendre “à l’instinct”.
Le jour où j’ai découvert le modèle OAMM
C’était en 2011, et je me souviens encore du déclic.
Le Online Analytics Maturity Model (OAMM), imaginé par Stéphane Hamel, m’a permis de mettre de l’ordre dans le chaos.
Enfin un cadre qui donnait une vision d’ensemble.
Et surtout, une question simple : où en sommes-nous, réellement ?
Ce modèle explore six dimensions : la gouvernance, les objectifs, la portée, les compétences, la méthodologie, et l’usage des outils.
Et il invite à se positionner sur une échelle de 0 à 5.
Un petit test qui, dans les faits, vaut souvent une séance de thérapie collective.
Ma première expérience : quatre feuilles, quatre visions
À l’époque, j’ai lancé l’expérience.
Quatre collègues, quatre profils : direction e-business, projets, production, analytics.
Même modèle, même consigne : “notez notre niveau sur chaque axe”.
Résultat ?
Quatre visions radicalement différentes.
L’un se voyait à 4 sur 5 (“on est bons”), l’autre à 1 (“on part de zéro”), et les deux autres… préféraient ne pas trancher.
C’est là que j’ai compris que la maturité analytics, ce n’était pas une mesure.
C’était une conversation.
Les trois paliers de maturité, en clair
Avec le temps, j’ai fini par repérer trois grandes étapes dans cette progression :
1️⃣ Le stade exploratoire : on mesure, on bidouille, on s’émerveille.
On découvre la data comme on découvre un nouveau jouet.
2️⃣ Le stade structuré : on définit des KPIs, des process, on formalise les comptes rendus.
C’est le moment où la data devient sérieuse… parfois un peu trop.
3️⃣ Le stade intégré : la donnée n’est plus un sujet, elle est partout.
Les métiers s’en servent naturellement, les décisions s’appuient sur des faits, et l’on commence à parler le même langage.
Le vrai passage se joue là : quand on cesse de produire des rapports pour prouver et qu’on commence à les partager pour comprendre.
Ce que j’en retiens aujourd’hui
La maturité analytics n’est pas un tableau de bord à remplir.
C’est une culture à construire.
Et comme toute culture, elle demande du temps, de la pédagogie, un peu d’humour et beaucoup de patience.
Je continue à croiser des organisations qui veulent “faire parler leurs données” alors qu’elles n’ont jamais appris à les écouter.
Et souvent, tout commence par une question très simple :
“Qu’est-ce qu’on veut vraiment comprendre ?”
Le reste, ce sont des outils.
Sans maturité analytics, les plus belles analyses du monde ne servent à rien. Et parfois, il suffit d’une conversation pour que tout change.
Aujourd’hui, avant de créer une analyse, j’aime évaluer le contexte.
Car trois métriques bien comprises valent mieux que cinquante mal exploitées.
Et surtout, j’y mets ma posture d’accompagnante. Sensibiliser, créer des rituels, former à l’interprétation.
Comme avec les profils atypiques : on adapte l’environnement, pas la personne.
Cet article fait partie de la série #DataChocolat – Clarté et audace dans le digital et l’humain


Laisser un commentaire